Je suis quelqu’un d’aussi bien que tous ceux que je fréquente, tous ceux que je fréquente étant des gens de bien.
Je ne fréquente que des gens de bien.
Et c’est bien.
Et ma mère devait également être quelqu’un de bien.
Sans quoi je ne serais pas moi-même quelqu’un d’aussi bien.
C’est logique.
Content de moi, content de la vie, content d’être quelqu’un de bien, je remplis ma tâche. À la lettre ; ma tâche, ni plus ni moins, seulement ma tâche. Faire ce que j’ai à faire, et le faire bien. Je suis là pour cela, et quand cela sera fait, je ne servirai plus à rien ; alors ma vie sera terminée, et je mourrai.
C’est si simple.
C’est normal.
Cela va de soi.
Je vis dans un monde clos où je demeurerai claustré jusqu’à la fin de l’histoire ; je n’ai plus qu’à attendre.
Je suis né en hiver ; la mort me rendra au froid dont la vie m’a détourné un instant.
C’est tout.
Une existence paisible, qu’il suffit de laisser se dérouler pour la mener à son terme.
Une vie facile.
Des gens bien.
Le jour se lève et je suis seul.Je suis seul dans le froid blanc de la brume d’hiver.
Et toute cette clarté — trop de clarté. Si aigües se découpent les formes ; cette clarté qui me transperce.
Clarté creuse, vide — et le froid du vent de l’aurore.
Horreur d’une aurore dorée — doigts de rose teinté de blanc.
Tout le blanc du matin. Matin d’avant le soir.
Le jour se lève ; je suis seul face au soleil, rond là-bas tout en bas, ce soleil cou coupé qui tout à l’heure brûlera les cœurs, desséchera la terre, puis s’en reviendra au néant, en si peu de temps que peu s’en seront rendu compte ; ce soleil sec comme le plomb qui, juste avant la nuit, éclairera un bref instant jusqu’au tréfonds de ce qui est caché.Le jour se lève ; et je suis seul dans le vent pâle qui chasse les ténèbres.
Et je suis seul.
Ce jour sera nouveau ; ce jour sera neuf.Ce jour sera différent des autres.
Plus grand encore que le paysage est aujourd’hui le silence du matin. Plus grand que le blanc de l’hiver.
Un indicible sentiment m’étreint soudain, qui s’éprend de moi.
L’impression que le monde est infini.
Et l’infini m’appelle.
L’hiver et le froid. Je me demandais bien ce qui avait pu me pousser à sortir en pareille saison, moi qui, comme il me seyait alors, étais demeuré cloîtré chez moi depuis un temps immémorial.
Certainement pas le paysage, en tout état de cause. Je ne connais atmosphère plus triste que celle d’une grande ville en hiver ; à plus forte raison par un hiver sans neige.
Si encore il avait neigé ! Mais nulle trace de blanc dans le paysage, nonobstant la température négative. Qu’il fait froid en hiver !
Soudain m’apparut-il pourtant que l’étrange effet que me faisait la ville eût aussi bien pu être le fait de la neige : ensevelissante, la brume qui flottait dans l’air glacé palissait la grisaille urbaine et étouffait les sons de la vie.
Je me sentis alors évoluer comme dans l’hypothétique éther d’un monde improbable, tel un voyageur accostant sur un rivage inconnu ; tel un être de papier franchissant la marge blanche de son histoire.
Ainsi, pour ainsi dire, subsumé dans mon extradiégèse, je poursuivis ma progression comme un être aérien et volatil ; je sentais l’air froid passer à travers moi sans frissonner aucunement ; j’entendais sur le sol le son de mes pas sans avoir la moindre impression de me déplacer.
Incongrument me vint l’idée que le décor citadin qui m’entourait avec netteté pouvait n’être qu’une quelconque image impalpable disposée là dans le seul but de me tromper. Aurait-ce été là ma punition pour avoir fui mes lares ?
Quoiqu’il en fût, pouvoir ainsi voir le monde sans moi, et contempler à loisir un paysage dont j’étais absent, me procurait une grande satisfaction intellectuelle ; et, charmé par ce nouvel aspect que je découvrais aux choses, je décidai donc de poursuivre ma promenade.
C’était l’hiver, et le jour, levé depuis peu, paraissait déjà décliner. D’épais nuages masquaient le viel et lui donnaient une teinte blafarde. Sous cette lumière éburnéenne, les bâtiments semblaient des eaux-fortes, et le sol, un monotone fusain. Le brouillard givrant, le ciel blanchâtre, et cette asphalte d’albâtre conféraient au tableau une sensation carcérale. Comment pouvais-je être davantage reclus à l’air libre que chez moi ? Comment pouvait-on me refuser l’accès au soleil en un jour pareil ?
Le solstice est un temps hors du temps ; un jour où l’on voyage, un jour où l’on s’en retourner ; un jour où l’on peut franchir la barrière qui nous sépare de ce qui est caché.
Le premier jour de l’hiver.
Je me répétai plusieurs foirs en moi-même mon mécontentement de devoir renoncer à des préoccupations aussi hautement poétiques que profondément philosophiques, puis me rendis compte que je m’étais fort éloigné de chez moi. Il m’allait maintenant falloir songer à m’en retourner, ce que je fis séance tenante, d’autant plus hâtivement que le jour s’assombrissait à vue d’œil. Le gris clair du ciel en effet se teintait d’un bleu violacé étrangement lumineux, et parait le paysage, ombres et pénombres, d’une tonalité lugubre.
Soudain les nuages disparurent, laissant éclater un coucher de soleil grandiose et magnificent.
Frappé de stupeur, je m’arrêtai net.
Le disque m’adressa encore, du fond de son agonie, ses derniers rayons nacrés, puis s’éteignit.
C’était l’hiver ; il faisait nuit.
C’était l’hiver.
Il faisait froid.
Connaissez-vous cette heure ?C’est l’heure exquise où le jour décline, où la lune, triste, s’élève entre douceur du soir et fraîcheur du crépuscule...C’est l’heure où le calme blanc vespéral se voile du rose des ténèbres.
C’est le soir charmant dans l’air duquel tournent sons et parfums.
C’est le couchant des cosmogonies.
Au moment où, parmi le poudroiement des fleurs vaporeuses, s’ouvre le mirabilis...
Connaissez-vous cette heure ?Connaissez-vous la douceur de sentir la fin de la soirée ?
Au moment où la face cachée des choses se dévoile...
Connaissez-vous cette heure ?Au moment où le froid prend le dessus.Au moment où la peur du noir se réveille.
Au moment où sortent les bêtes.
Au moment de l’inconnu.
Il est l’heure de dormir.
La nuit tombait et je n’avais pas sommeil.
J’étais fatigué, mais sans l’envie de dormir.
Qu’elle tombe tôt la nuit de l’hiver.
Ils rentraient chez eux.
J’aurais dû rentrer moi aussi. Mais malgré le froid insidieux qui me brûlait les os, l’air me paraissait sympathique ; je m’étais arrêté de nouveau. Je me sentais bien.
La nuit était tombée complètement. Seules subsistaient les lueurs orange dans le ciel encore bleuté.
Les façades se constellaient de rectangles jaune pâle, parfois teintés par intermittence de bleu ; je devinais des postes de télévision, des meubles, des pièces ; des gens, des familles, des vies. Qu’ils semblaient petits ces gens, dans leur vaine agitation, en la finitude de leurs intérieurs ; qu’à la clarté des lampes le monde était petit !
Qu’avais-je donc de plus qu’eux ?
N’avais-je pas moi aussi un chez-moi où je passais le plus clair de mon temps ? Mon horizon n’était-il pas borné au possible ? Ne remplissais-je pas ma tâche, seulement ma tâche, dans ce monde clos où j’allais demeurer jusqu’au bout ?
Certes. Mais en ce moment, j’étais dehors.
Moi, j’étais dehors — là était la différence. J’étais toujours debout, j’étais encore dehors.
Et c’est à ce moment précis que j’ai su pourquoi j’étais sorti.
Je suis dehors, il fait froid, il fait nuit, c’est l’hiver et je n’ai pas sommeil. C’est l’hiver et c’est la nuit ; il fait froid et il fait noir, je suis le maître de ce schéol qui s’éveille. Je suis seul, je suis le maître.
À ma gauche passent quelques voitures. Vouivres hurlantes dans la nuit ; éclair et lumière, tache rouge dans les ténèbres. Ce sont les derniers ilotes, qui s’enfuient vers leur foyer avant que quelque mâne divaguante ne les surprenne.
Qu’ils fuient donc ! Je reste.
Je reste au royaume des ombres.
Je reste dans le feu du soir.
Je reste dans le calme de la nuit, où mes pas, assassins du silence, se placent lentement, mécaniquement, devant moi. Je ne marche plus que par habitude ; je n’ai pas envie de rentrer. Je suis seul. Je suis quelqu’un de bien.
J’effleure le lampadaire, dont le métal froid me givre la lymphe. Je n’ai pas peur des bêtes de la nuit, je n’ai pas peur du noir, pas peur du noir froid de l’hiver, pas sommeil. Je reste là, seul, debout, debout dans la nuit, éveillé parmi les morts.
Que l’heure sonne et la nuit vienne — je demeure.
Des pas secs, froids.
Des pas réguliers et implacables qui claquent un à un, de plus en plus proches. Je me retourne.
Une femme, en noir, en face, sur l’autre rive. Elle va droit devant elle, ne se retourne pas, ne se détourne pas.
Moi non. Je suis de l’autre côté, celui de ceux qui veillent, celui de ceux qui restent.
Soudain.
Elle m’a vu. Ébauche d’un sourire, et le pas ne cessent pas. Une lueur, puis la nuit. Plus qu’un souvenir. Plus qu’un relent de rêve.
Elle est belle. Elle est belle comme le clair de lune la nuit au-dessus d’un étang. Je ne sais d’où elle vient, je ne sais d’où elle va. Je sais simplement que je ne la verrai plus.
C’est là que nos chemins se séparent.
Nous ne nous verrons plus. Nulle part.
Je l’oublierai. Elle m’oubliera comme je l’aurai oubliée.
C’est aussi la nuit la plus longue.
C’est l’hiver ; il fait nuit ; il fait froid.Qu’elle est longue la nuit de l’hiver.
Qu’elle est longue cette nuit qui glace le cœur, gèle la terre, et confère à l’air ce froid des choses qui sont restées trop longtemps cachées.
Qu’elle est longue cette nuit quand il est temps de dormir.
Froid et nuit. Nuit où je me promène, nuit du solstice, où ce qui est caché se dévoile.Il fait nuit et je suis seul.
Je suis seul ; et je marche.
La nuit est infinie ; et l’infini m’appelle.Mes pas résonnent sous moi dans les ténèbres oranges. Mon corps, glacé par l’air dur, n’est plus qu’un mouvement, plus qu’un moment dans ce désert ocre de formes et d’ombres qui m’emprisonnent.
Un jeu de lumères où tout est illusions.
La rue qui défile à mes côtés semble n’avoir pas de fin. Toujours les mêmes immeubles, toujours le même intervalle entre les lampadaires, toujours le même pavement.Je suis pris au piège du labyrinthe.
Les créatures de la nuit ne m’effrayent pas. Mais je crains les hommes et leurs édifices.
J’entends soudain tous les peuples qui dorment, dont les voix vaticinent dans l’ombre. La tête écartelée par leur murmure, je m’enfuis comme un quadrupède cagneux.Trébuchant et claudiquant, je m’enfuis, je m’en vais.
J’erre de ci, de là ; je vogue, je vole et je m’envole ; je suis, je fuis, je cours.
L’automne et il fait nuit — je cours.
Septembre et il fait nuit.
Novembre et il fait nuit.
Décembre ; et le soleil se couche.
Et je cours.
Nuit qui excites les fous, nuit aux douceurs de femme. Nuit transfigurée. Nuit d’ivoire.
Nuit à travers laquelle je cours.
Ô nuit, réclusion des esprits. Marteaux sans maître d’un piano ; fracas des spirales de soie vibrante. Fer de l’enfer, morsure d’archet. Littérature statique.
Nuit de peur ardeur odeur chaleur ; peurs et lueurs...
Nuit à travers laquelle je cours.
Je cours plus vite que le solstice. Je cours à travers la ville, je cours à travers la nuit. Je cours dans le noir d’un hiver sans espoir.
Je rentre chez moi.
C’est l’hiver ; il fait froid.L’hiver et le froid. Pourquoi donc suis-je sorti ? Qu’il fait froid en hiver !
Le vent se lève sur le blanc du matin d’un jour neuf.
Les cormorans mourants qui tournoient dans le ciel silencieux.
Le silence des corps des cœurs morts qui m’écœurent.
Le souvenir d’un solstice hostile, jour oublié d’un voyage révolu.
L’impression d’un changement, intangible et fugace.
C’était l’hiver, le début de l’hiver.C’est l’hiver et je suis encore dehors, toujours debout.
Les lumières se sont éteintes. Ne reste plus que le vide.
Plus que la brume, pâlissante en cette heure de douleur que je connais si bien.
Plus que le blanc.
Je marche seul dans le vent du matin qui chasse les ténèbres.
Matin d’après le soir ; je rentre chez moi.
Je suis quelqu’un de bien.
Je ne fréquente que des gens de bien.
Mes pareils.
Des gens de bien.
Une existence paisible.
Une vie si facile qu’il suffit de la laisser se dérouler pour qu’elle arrive à son terme.
C’est tout.
Janvier 2000.
 [Le Site]
[Le Site]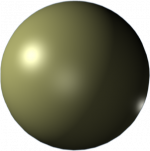 Solstice
Solstice