Que vous soyez élève instrumentiste dans un conservatoire prestigieux ou dans une petite association de quartier, il est un mot que vous serez très probablement amené à entendre et utiliser.
Ce mot, employé tour à tour avec fierté ou avec honte, constitue probablement le dénominateur commun de toute classe d’instrument ou de chant, et pourtant il n’a strictement aucun rapport avec la technique musicale ; ce mot, je ne me souviens pourtant pas l’avoir utilisé une seule fois en plus de dix ans d’enseignement — au point que je me demande parfois si cela ne fait pas de moi un prof indigne de ce nom.
Ce mot est : enregistrement.
Cela peut être le prof, qui demande, après avoir vu pendant six semaines l’élève s’acharner sur un morceau : « et sinon... tu as écouté l’enregistrement ? »
Cela peut être l’élève, au contraire, qui alors que son professeur lui fait une suggestion de tempo, objecte avec fierté : « j’ai écouté l’enregistrement, il le joue plus vite » !
Cela peut être l’objet d’une conversation mondaine, d’aucuns (professeurs ou élèves confondus) jugeant de bon ton de comparer les « différentes versions » enregistrées — l’on opposera ainsi à « la version de Nat » des sonates de Beethoven, celle de Kempff, ou encore — très chic — l’on comparera les différentes versions successives de Brendel.
Cela peut être le seul moyen pour un instrumentiste défavorisé — c’est-à-dire ne jouant pas de piano et ne pouvant s’offrir un accompagnateur — d’avoir la moindre idée de ce à quoi peut ressembler le morceau qu’il travaille. Grande est alors la tentation de tenter de « jouer avec l’enregistrement », ce qui a conduit certains éditeurs de partitions à se précipiter (versant quelques gouttes de salive au passage) sur le marché des « versions instrumentales » et autres « enregistrements d’accompagnement », transformant ainsi lentement mais sûrement les cours de musique en karaoké.
Mais c’est avant tout et incontestablement, l’aveu d’une défaite par abandon : celle par laquelle l’on renonce à son statut de musicien doué d’intelligence qui fait l’effort intellectuel de lire la partition et tente de la comprendre, pour se transformer en auditeur-légume qui se laisse passivement gaver de musique, avant de passer — dans le meilleur des cas — au stade d’instrumentiste-perroquet en tentant de reproduire ce que l’on vient d’entendre.
Le son en boîte, aliment pour les masses
Certes, la musique n’a pas toujours été écrite, en particulier dans les milieux populaires. Certains langages d’expression musicale reposent même sur une large part d’improvisation, par essence non-écrite. La notation occidentale classique de la musique, d’ailleurs, n’a pas toujours été aussi précise, et ne saurait prétendre à une quelconque universalité. Cependant, il ne viendrait à l’idée de personne de soutenir que l’alphabétisation est une chose nuisible, sous prétexte que les cultures populaires de nos ancêtres étaient principalement orales : d’où vient, alors, que la musique écrite soit aujourd’hui reléguée au rang d’objet antédiluvien et superflu, dont on sait tout juste qu’il servait à amuser de vieux bonshommes en perruque qui sont morts depuis deux siècles ?
C’est que la musique écrite a fait les frais du processus de ringardisation organisée de la culture savante que j’ai souvent décrit ici, et qui bénéficie de la conjonction des effets de mode (toute génération ayant tendance à se définir une « contre-culture » par opposition à ses ainés), du progrès technique (et du goût pour la modernité qui l’accompagne, avec son cortège de « besoins nouveaux »), et surtout des intérêts bien compris de toute une industrie médiatique : vendre des partitions ? Cela ne concernera qu’une poignée de personne qui sauront les lire. Vendre du son ? Potentiellement, tout être humain doté d’une oreille ou deux deviendra votre client.
(C’est même pire que cela, puisqu’indépendamment du support sonore vous pourrez considérer comme client — et de ce fait, rançonner — quiconque aura le malheur de passer par là et d’entendre votre son. De l’art de vendre de l’antimatière.)
Ainsi s’est instauré dans notre société un culte de la captation artificielle sonore et visuelle, qui depuis un siècle fait les délices des industriels du divertissement de masse. De cette dérive, je ne présenterai que quelques signes marquants, au premier chef desquels la grande ruée vers l’or qu’a constitué au XXe siècle l’industrie du disque, tout à la fois objet de consommation courante et produit de luxe. Les bals populaires se sont faits discothèques, les musiciens, « D.J. » (la mauvaise conscience bourgeoise ayant eu tôt fait de consacrer comme art le fait de pousser trois boutons : c’est même mieux qu’un art, comme le montre l’acronyme anglo-américain, forme ultime de la reconnaissance sociale). Autre signe intéressant — également désigné sous un vocable anglo-américain —, la mode du « home studio » qui fleurit depuis quinze ans, accessoire bourgeois aussi irremplaçable que l’était le piano autrefois (davantage bourgeois sans doute, puisque plus cher et plus encombrant).
Bien plus — et c’est pourquoi je parle de « captation artificielle » —, une fois le son déconnecté de l’instrument qui le produit, à quoi bon s’encombrer encore de ce dernier ? Un déplacement métonymique contre nature s’est ainsi produit, qui conduit aujourd’hui les instruments à être relégués au rang d’accessoires superflus tandis que leur « son » supposé est censé exister par lui-même, par les merveilles de la synthèse. Ainsi de cet argumentaire publicitaire (que j’ai amplement pourfendu, au grand dam de mes lecteurs les plus naïfs ou les moins cultivés) qui vous invite à acheter des « pianos électroniques » (oxymore au demeurant inepte sinon malhonnête) pour « remplacer », « en mieux », votre piano ringard-puisque-non-électronique.
La vogue des logiciels de synthèse musicale depuis vingt ans, a aussi permis à n’importe qui de se proclamer « compositeur » (et d’être reconnu comme tel, j’y reviendrai dans un futur article) sans avoir à apprendre le moindre rudiment d’un langage musical quel qu’il soit ; quant aux logiciels commerciaux d’édition de partitions, on ne leur demande aujourd’hui guère que deux choses : en amont, de pouvoir rédiger la partition « eux-même » d’après une entrée sonore ou MIDI, et en aval, de pouvoir jouer la partition « eux-même » !
Pour tout aspirant chanteur ou groupe de rock/rap/variété/que sais-je, l’étape cruciale et indispensable est toujours l’enregistrement, parfois fort onéreux, d’une « maquette » ; afin d’éviter cette étape, d’innombrables petits groupes sur le Web se tournent vers la « musique électronique », qu’ils produisent avec plus ou moins de bonheur, et souvent au kilomètre. La culture de masse n’est pas la seule affectée : les musiques non-écrites (jazz, rock, variété, électronique, rap, que sais-je) ont fait l’objet d’une ahurissante entreprise de récupération/légitimation sous la dénomination de « musiques actuelles », dont je ne sais si elle est plus absurde qu’insultante ; et en sens inverse, les milieux autrefois légitimés s’inféodent aujourd’hui totalement à l’état d’esprit inculte-et-fier-de-l’être de la bourgeoisie « décomplexée ». Ainsi, je me trouve de plus souvent à m’entendre dire par des ensembles instrumentaux à qui je tente de présenter mes partitions : « Vous n’auriez pas plutôt une maquette ? »
(Pardon ? Avez-vous dit « des baffes qui se perdent » ? Ah non, c’était moi qui pensais tout haut, veuillez m’excuser.)
L’enregistrement, miroir aux alouettes
S’il ne manque sans doute pas d’avantages, la valeur de l’enregistrement sonore en tant qu’objet d’art me paraît pourtant éminemment discutable.
Ne serait-ce que par sa séduction mensongère : là où le public sait parfaitement s’il est assis dans une salle de cinéma et regarde un film ou s’il se trouve dans une salle de théâtre face à de vrais comédiens, l’écoute d’un disque ne vous fournira que très rarement cette mise à distance et pourra facilement vous conduire à prendre pour une véritable interprétation telle que l’on pourrait l’entendre en concert, ce qui n’est que le résultat de manipulations du son plus ou moins subtiles. (D’où l’argument de vente du « live », où le son n’est pourtant qu’à peine moins manipulé qu’en studio.)
J’en veux pour illustration l’accroissement inimaginable, destructeur et ridicule, du niveau d’exigence technique depuis un demi-siècle dans les conservatoires — même si ce phénomène est également la conséquence et l’indice d’autres idéologies telles que l’athlétisme et le jeunisme de notre société. À ce titre, le culte de l’enregistrement est d’ailleurs à rapprocher de l’idéologème qui sépare arbitrairement les « amateurs » des « professionnels », que je rejette et dénonce de longue date.
C’est en vain que l’on a feint de croire que les disques n’étaient pas les ennemis de la musique savante (à grands renforts de distinctions purement spécieuses, de magazines spécialisés, de star-system et j’en passe) : s’il ne fallait donner qu’un exemple du mépris insondable en lequel l’industrie tient la culture digne de ce nom, je le trouverais dans ces hypermarchés du disque où est invariablement regroupé, sous l’appellation « classique », tout ce qui a pu s’écrire en Occident entre 1530 et 1950 — le reste étant bien évidemment ignoré. Je ne peux qu’avouer mon incompréhension en voyant tant de clients sincères et cultivés — parmi lesquels peu d’authentiques musiciens, au demeurant — se presser autour de ces rayonnages où la culture se vend au poids (outrageusement cher du reste). Si le disque peut donner l’impression de se rapprocher d’une musique absolue et idéale, il n’en est rien : même si, abusivement érigé en « référence », un enregistrement forge de fait nos systèmes de représentation, il n’en impose pas moins un sens de lecture, exactement de même que vous ne pourrez considérer avoir lu un roman après avoir simplement vu un film qui prétend en être adapté.
Avez-vous déjà remarqué, au fait, combien lire une partition est comme lire un roman ? (L’un comme l’autre requiert de savoir lire, bien sûr, mais supposons que vous lisiez la musique aussi bien que les mots.) Cela exige de la part du lecteur une implication active, et un effort d’imagination. Lecture bien plus agréable que l’écoute d’un disque, qui envahit votre intérieur et vous impose sa dynamique : en tenant une partition, c’est tout naturellement que l’on peut sauter quelques pages, s’attarder sur une harmonie, revenir sur telle ou telle mesure...
Même certains amateurs d’enregistrements ne rechignent pas à re-découvrir, sous forme écrite, une musique qu’ils connaissent déjà (ou croient connaître) ; l’engouement pour les song books en témoigne. De même, les instrumentistes capables de déchiffrer quelques partitions sur leur instrument, savent tout le bonheur (souvent coupable car méprisé par le Culte de l’Enregistrement) qu’il peut y avoir à déchiffrer une partition, très lentement ou très doucement (et dans tous les cas, « très mal » par rapport au Disque) mais toujours de façon ô combien gratifiante. La musique non-écrite n’attend que d’être figée et artificialisée après captation ; la musique écrite, elle, est appelée à vivre.
Le métier d’interprète
Il est établi depuis longtemps que n’importe quelle conversation entre deux être humains fait intervenir une large proportion de communications non-verbales, c’est-à-dire en grande majorité des signes visuels (posture, gestuelle, mimiques). Il en va de même en musique : un interprète n’est pas simplement un fournisseur de son, c’est aussi et avant tout quelqu’un qui, sur scène, s’adresse à vous.
C’est dire, alors, tout ce qu’est vouée à perdre toute tentative de captation sonore — ou même visuelle : ce ne sera qu’une trace, qui du reste ne laissera que bien peu de place à l’imagination. La vidéo elle-même n’apporte pas grand chose, si ce n’est une trace supplémentaire (à son tour incomplète et frustrante).
Si ce que le musicien dit vous importe plus que la façon dont il vous le dit, alors, certes, vous pourrez peut-être vous contenter de cette trace (c’est mon cas, et c’est pourquoi je suis absolument indifférent aux questions de « versions » de différents interprètes : je n’écoute des enregistrements que pour entendre les notes, et si je peux disposer de la partition je n’ai strictement aucun besoin de quelque enregistrement que ce soit). Mais si vous vous attachez véritablement à cet acte de communication qu’est la présentation en public d’une pièce de musique, la communication non-verbale vous sera certainement irremplaçable : c’est seulement en discernant (ou en croyant discerner) le sourire en coin du pianiste lorsqu’il entame son Scherzo, que vous comprendrez pourquoi il fait ces notes piquées de façon ironiquement sèche, qui sur un simple enregistrement vous aurait sans doute paru aigrelette et non ironique.
Je ne suis pas partisan, pour autant, de la façon dont une certaine idéologie à la mode a consacré le « spectacle vivant » (ceux qui emploient cette expression sont d’ailleurs souvent les mêmes que ceux qui parlent « musique actuelle », ça doit être l’air du temps, c’est le hype, coco) ; je pense qu’il n’y a strictement aucun rapport ni parenté entre la démarche artistique d’un interprète de musique écrite, d’un musicien de « variété », d’un comédien ou d’un danseur — et je considère que les programmateurs, producteurs ou « artistes » qui mettent toute leur énergie à concevoir des spectacles « pluridisciplinaires » (coco), se fourvoient au mieux dans un sacrifice sincère aux divinités de la Mode, au pire dans un gadget branché dont la seule raison d’être est de servir d’appeau à subventions.
D’ailleurs, concevoir la musique comme un « spectacle » me semble quelque peu superficiel ; ce biais trouve son paroxysme dans les concerts de musique pop où, malgré la présence apparente sur scène de stars et d’instrumentistes (lesquels sont parfois des danseurs munis de guitares), une large partie de la bande-son est en fait pré-enregistrée ou pré-traitée.
Qu’on le nomme spectacle ou concert, le moment de transmission (voire d’échange, car il existe aussi une communication du public vers l’interprète) que constitue un évènement public, me semble donc riche d’une véritable altérité : l’auditoire y est obligé de se confronter à cet Autre qu’est l’interprète, dans toute son individualité, tout son potentiel de surprises, plaisantes ou déplaisantes. En concert, pas question de baisser le volume si la musique est trop forte, de monter le son ou de « mettre sur pause » le temps d’aller aux toilettes ! Il vous faudra accepter l’interprétation dans toute sa masse sonore, même violente ; tendre l’oreille si elle se fait diaphane ; et... vous retenir.
Coquille de son
La transmission radiophonique, à ce titre, relève d’une situation quelque peu intermédiaire : vous pouvez, certes, ajuster le volume de votre récepteur... mais le choix ne vous est pas laissé de ce que vous allez entendre — et la surprise est donc toujours possible (quoique trop rare dans les faits). Il convient à ce titre de différencier la grande majorité des stations de radio (privées mais parfois publiques) où la playlist se déroule nonchalamment, éventuellement entrecoupée de réclames invariablement intrusives et agressantes (c’est leur raison d’être)... et les stations sur lesquelles un présentateur s’adresse à vous, encadrant par ses annonces et commentaires les enregistrements musicaux dont il peut ainsi pallier, en partie, la pauvreté — mais aussi l’aggraver !
Cette pauvreté — artistique, expressive, éthique — des pistes musicales sonores a donné lieu, depuis bien longtemps (et avant même la reproductibilité mécanique du son), à la notion de fond sonore. Le son n’y est qu’une coquille vide, conventionnelle et codifiée, par dessus laquelle est censé prendre place un évènement présentant davantage d’intérêt — ce qui, évidemment, n’a guère tardé à s’inverser, la présence du fond sonore étant chargée à elle seule d’indiquer ce qui est censé être intéressant et d’en orienter la lecture. (Dérive ultime, la notion même d’intérêt finit par disparaître, le son ne se faisant plus que signe purement indicatif, avec pour tout message que « vous vous trouvez dans un ascenseur » ou « ceci est un restaurant chinois ».) Dans bien des cas, le message prime sur son vecteur : ainsi de l’équation « musique de danse = fête » qui gouverne aujourd’hui la majeure partie des rassemblements sociaux, mondains, pré-sexuels ou festifs, et où le langage musical se résume peu ou prou à une pulsation métronomique affirmée sans ambiguïté aucune (ni le moindre respect pour l’intelligence éventuelle de l’auditeur, ni le moindre égard pour son appareil auditif). Un « BPM » (beats per minute, tempo métronomique mesurée en nombre de pulsations par minute), une basse bien grave, une « boîte à rythmes » toute prête (et calée en carrures de quatre mesures), un vague enrobage à base d’accord et de voix éthérée, et vous tenez un produit prêt à être consommé dans les supermarchés et discothèques — jamais le « son en boîte » n’aura si bien porté son nom.
Sans minimiser ce que la notion de « musique de fond » a de dégradant pour un musicien (il faut avoir été pianiste de bar dans des réceptions huppées pour le mesurer pleinement, encore qu’à partir d’une certaine heure cela peut donner une vision assez salutaire de nos classes dominantes — et prouver qu’en quantité suffisante, le champagne ne remplit guère d’autre office que le gros rouge), elle me semble pourtant présenter moins d’hypocrisie que l’idéologème évoqué plus haut qui consiste à faire passer l’enregistrement pour « la » musique (complète, achevée, idéale). Au contraire, quiconque consomme du son « en fond » montre qu’il a parfaitement conscience de ce que ces pistes sonores ne se suffisent pas à elles-mêmes. Et l’enregistrement devient alors ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un simple support, sur lequel peuvent se développer d’autres évènements, d’autres lectures ; la musique de film est à ce titre un excellent support, certes très convenu et globalement peu travaillé mais souvent d’une grande qualité (c’est d’ailleurs, pour beaucoup, une occasion unique d’entendre de la musique orchestrale et authentiquement instrumentale).
L’usage des baladeurs participe d’une même démarche : marcher dans la rue en écoutant une piste sonore, c’est construire soi-même l’arrière-plan musical de son propre film ; c’est aussi, et je ne peux que l’encourager, faire de la musique un objet familier, que l’on transporte avec soi — par « musique », j’entends ici : un certain langage musical, de son choix. Mais je suis toujours impressionné et ravi de découvrir que certains de mes élèves transportent avec eux un catalogue personnel où se mêlent chansons de rock, musiques de film et Nocturnes de Chopin !
Dans le mur (du son) ?
Alors bien sûr, les baladeurs d’aujourd’hui ne sont point ceux d’autrefois qu’il fallait nourrir de cassettes ou de disques, non : l’avenir est (nous dit-on) à la dématérialisation, aux boutiques en ligne de fichiers sonores et au streaming !
Et pourtant, aucune des critiques que je formulais plus haut ne me semble invalidée par la dématérialisation du support. Bien au contraire : le malheur (aidé par l’inculture technologique du grand public et par l’avidité d’une certaine industrie informatique) a voulu que se répande de façon omniprésente et hégémonique des formats d’échantillonnage et de compression du son absolument épouvantables, condamnant l’humanité toute entière sur plusieurs générations à une habitude d’écoute si grossière qu’elle confine au handicap. Cette calamité planétaire trouve son apogée (et son porte-étendard) dans l’infâme troisième couche du format mpeg 1 (qui n’en demandait pas tant), offerte en pâture aux masses sous le sigle MP3 — avec, au passage, une substantielle manne financière à base de trafic de brevets pourtant illégitimes dans la plupart des pays, le nôtre compris. À quelques exceptions près où les limitations techniques ont été pleinement intégrées dans les langages eux-mêmes (low-fi, 8-bits), je pense qu’une telle amputation sonore ne devrait être tolérée pour aucun langage musical, qu’il soit électronique ou acoustique, instrumental ou vocal — la première victime étant bien sûr les percussions en métal, pourtant essentielles dans bien des musiques réputées « populaires ».
Outre leur trop faible qualité, les formats non-Libres de compression sonore sont également le théâtre de tout un trafic de restrictions et de monopoles : pistes sonores dont la copie est (soi-disant) impossible, baladeurs qui ne liront qu’un format de fichiers... Le consommateur est peu informé, et l’industrie le sait : elle sait pouvoir compter, pour l’essorer soigneusement, sur son consentement béat et hâtif. Qu’il puisse se trouver autant de gogos pour acheter ce genre de verroterie numérique, engraissant ainsi une fois de plus les mêmes ruffians qui s’étaient déjà goinfrés avec le vinyl, les musicassettes et le laser, n’est guère qu’une illustration de cette défaite de la Raison que trahit l’appétence de notre société vers le son en boîte.
Quant à l’argument de la « diversité culturelle », il fait long feu dans ce contexte, les marchands de son compressé ayant tout intérêt (de même que les radios commerciales) à mettre en valeur les pistes sonores qui en ont le moins besoin, c’est-à-dire les produits de consommation culturelle courante. S’entretient ainsi un entonnoir culturel où, bien loin de vous « ouvrir au monde » dans toute sa diversité, l’on s’emploie avant tout à faire en sorte que vous n’achetiez que ce que vous connaissez déjà : la surprise fait fuir, la familiarité fait vendre.
La revanche du son illégitime
Le réseau Internet, au demeurant, n’a pas été sans ouvrir une véritable brèche (qui n’a, malgré tous les efforts des industriels et de leurs laquais gouvernants prétendument démocratiques, toujours pas pu être comblée) en permettant et encourageant l’expression plus ou moins directe et la communication plus ou moins immédiate entre les citoyens. L’édifice du « son légitimé » a dû faire face (et dans certains cas, succomber) au déferlement d’une myriade de sons illégitimes : copies non-autorisées d’albums (parfois dans une compression sans perte), auto-distribution de certains musiciens, expression musicale « amateur », culture du détournement et du « remix »...
Ces outils nouveaux ouvrent, pour le musicien comme pour l’enseignant, des possibilités très vite irremplaçables — quoique souvent incompatibles avec une législation dépassée, injuste et absurde. Ainsi lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau morceau à travailler : là où de trop nombreuses générations d’élèves n’ont eu d’autre choix que de subir les sempiternels « recueils pédagogiques » bâclés par une poignée d’éditeurs français aussi mercantiles qu’incompétents, nous pouvons aujourd’hui choisir parmi d’immenses bibliothèques de partitions sous licences Libres. Et le fait de pouvoir écouter, sur des sites de streaming audio ou vidéo, des enregistrements, même très mauvais, permettent aux élèves de découvrir par eux-même quelques pièces du Grand Répertoire plutôt que de dépendre exclusivement de leur prof, ses goûts et ses travers.
Dans une même démarche d’émancipation ou (ré)appropriation, ces outils permettent également au musicien d’enrichir sa culture et son travail. Même si j’ai dit le peu d’estime que m’inspire ce sport qui consiste à aller « écouter l’enregistrement » et « comparer les versions » des pièces que l’on travaille, il est certain que plusieurs influences valent mieux qu’une, et que le Réseau des réseaux permet à tous d’élargir (légalement ou non) son champ d’étude. C’est encore plus nécessaire dans le cas d’œuvres dont on n’a pas la partition : les enregistrements étant bien plus abondants et facile à trouver en ligne que les partitions, c’est là une possibilité de consulter rapidement de nombreuses œuvres que l’on ne trouverait pas sans cela — particulièrement les œuvres dites « contemporaines », qu’un législateur peu intègre a cru bon de confisquer au domaine public auquel elles peuvent légitimement prétendre.
C’est aussi, lorsque l’on écrit de la musique, une possibilité unique de se documenter sur des instruments ou langages que l’on n’aurait sans doute jamais découverts, et certainement pas employés : ainsi de la flûte hulusi que j’ai récemment tenté d’utiliser dans une partition. Internet est ainsi l’espoir, peut-être irraisonné, d’une véritable communication culturelle entre les continents, plutôt que le processus de domination acculturatrice du reste du monde auquel l’Occident nous a habitués jusqu’ici. Que ce soit pour les spécificités instrumentales ou pour la découverte de langages musicaux non-écrits, l’enregistrement sonore (et éventuellement visuel) présente un intérêt documentaire primordial.
Vers un avenir autodidacte ?
Peut-être ce mouvement de réhabilitation du son illégitime est-il, paradoxalement, indice d’espoir pour la musique écrite. En effet, il montre la possibilité (tout au moins technique) d’un affranchissement du public vis-à-vis des injonctions médiatiques et de la culture « de masse » : en allant chercher par eux-même l’information plutôt que de devoir se contenter de ce qui leur est jeté en pâture, les citoyens peuvent éventuellement (re)découvrir la richesse de patrimoines culturels qui leur auraient été jusqu’ici, soit inaccessibles, soit interdits de fait car estampillés comme ringards.
Plus particulièrement, la possibilité aujourd’hui concrète, réelle et pratique, d’acquérir les savoirs que l’on choisit soi-même, pourrait inclure à terme des savoirs et savoirs-faire d’ordre culturel : des sites web permettent déjà d’acquérir les connaissances de base pour jouer d’un instrument ou déchiffrer une partition, des logiciels Libres permettent d’améliorer son oreille et ses connaissances théoriques, d’autres de rédiger ses propres partitions... Dès les tout-débuts du Web se sont constituées des bibliothèques (souvent illégales) permettant de retrouver vos musiques préférées et de vous les réapproprier sous forme écrite : ainsi des myriades de transcriptions au format MIDI autrefois, ou aujourd’hui de ces innombrables sites où l’on peut trouver les partitions de musiques de tel film ou tel jeu vidéo... s’ajoutant aux bibliothèques de partitions Libres que j’évoquais plus haut. Peut-on espérer que ceux-ci conduisent à celles-là ? Il est trop tôt pour le dire.
À travers ces usages, qui permettent d’accéder par un même moyen (l’ordinateur et le Web) à la fois aux enregistrements (synthétiques ou non) et aux partitions, s’instaure un nouveau rapport entre la musique écrite et la piste sonore : de même que les sous-titres d’un film étranger permettent de comprendre le film, l’enregistrement sonore permet de comprendre la partition pour tenter ensuite de la reproduire soi-même.
Dans ces nouvelles pratiques, la place du musicien traditionnel (et en particulier du professeur) s’avère limitée, sinon vouée à disparaître. Cela signifierait alors la victoire définitive de l’enregistrement sur l’enseignement, la perte d’un savoir et d’une certaine tradition instrumentale... Mais aussi la survie d’une pratique musicale vivante et authentiquement démocratique (puisqu’accessible à tous), dans laquelle l’écrit aurait une place. Tout comme l’Internet d’hier et le mouvement du logiciel Libre nous ont habitués à pouvoir accéder au code source et à comprendre les rouages des programmes, l’Internet de demain pourrait donner à quiconque le souhaite la possibilité d’accéder à la « source » de toute musique entendue ici ou là, c’est-à-dire à sa partition.
Déshérence de l’écrit
Reste à savoir de quel écrit l’on parle. Davantage qu’un texte, une partition est susceptible d’être écrite à de nombreux niveaux ; pour qui voudra simplement « voir les notes » derrière un enregistrement entendu, elle fournira obligeamment toute une série de points noirs sur des lignes, qui permettront de reproduire à peu près les harmonies et mélodies entendues — reproduire, sans nécessairement comprendre. Mais à qui sait lire et observer attentivement, chaque choix du compositeur adresse un message très fin : parfois textuel (dans le cas des indications d’expressivité ou de tempo), parfois implicite (dans le placement d’un phrasé, le choix d’une ponctuation). Sans parler, naturellement, des choix musicaux eux-mêmes et de la construction dramatique du discours : jeu de piste, surprises, gratifications,...
Encore faut-il, naturellement, que ces finesses soient à lire dans la partition. Or nous avons assisté ces dernières décennies — particulièrement en France — à un singulier appauvrissement de l’édition musicale (j’entends par là la qualité, et non son chiffre d’affaires, qui, concentration capitaliste aidant, se porte on ne peut mieux). L’on nous vend ainsi maints recueils (particulièrement dans le répertoire pédagogique, méprisé comme la poule aux œufs d’or qu’il se trouve être) dont les pièces sont truffées d’erreurs, d’imprécisions, d’amputations, d’aberrations musicales ou historiques — lorsqu’il reste une seule note de la main du compositeur, puisque dans bien des cas ce ne sont que transcriptions, transpositions, réécritures, adaptations « facilitées », toutes rédigées au kilomètre et sans aucun talent ni souci musical : y trouver ne serait-ce qu’une nuance exacte est un évènement !
Les élèves ne semblent pas gênés outre mesure de cette inanité (dont ils ne prennent souvent même pas conscience, n’ayant aucune idée de ce à quoi ressemble une partition digne de ce nom) — comment le pourraient-ils ? Tout comme dans le cas d’une musique de film ou de jeu vidéo, ils ne consultent la partition (au mieux !) que pour voir les notes, et non pour s’interroger sur ce qu’exprime le compositeur. Tant que les notes correspondent à peu près à ce qu’ils ont pu entendre dans « l’enregistrement », tout va bien — et si des nuances ou des finesses d’expressivité sont requises, celles-ci viendront de l’enregistrement et non d’indications sur la partition, celui-ci s’étant de fait substitué à celle-là. La partition n’est plus qu’un aide-mémoire : le véritable support est la piste sonore, ou du moins le vague souvenir que l’on en garde.
En cela, la première tâche de quiconque enseigne la musique est de libérer ses élèves des préconceptions de l’enregistrement, et de montrer que la musique, même sous forme écrite, est un langage chargé de sens, personnel et expressif : nous, professeurs, avons pour responsabilité de donner vie à la partition sous le regard de l’élève, jusqu’au jour où il y parviendra de lui-même.
Même si ce n’est pas pour tout de suite.
En tout cas, pas aujourd’hui : là je dois vous laisser, j’ai une maquette à enregistrer au synthé, pour mon prochain opéra.
 [Le Site]
[Le Site]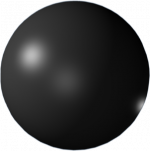 Du son en boîte
Du son en boîte
Messages
23 janvier 2012, 23:17, par Papageno
Il y a quelque temps j’ai lu une interview du pianiste et compositeur Frédéric Rzewski où il faisait justement remarquer que le XXè siècle restera peut-être dans l’histoire de la musique comme celuil où on avait la manie fétichiste et ô combien curieuse de vouloir figer la musique dans de petits bouts de plastique, l’enfermer, la conserver, la momifier et bien sûr la reproduire en masse. Est-ce que cette manie pourrait disparaître un jour ? Peut-être.
Vous ne m’en voudrez pas j’espère de pointer quelques menus contradictions dans votre article long et provocateur mais plein de réflexions sensées et profondes. En effet, vous chantez les louanges de Youtube ou d’IMSLP après avoir durement critiqué la radio et l’industrie du disque : mais ces médias ne font-ils pas en fin de compte la même chose, c’est à dire rendre la musique accessible au plus grand nombre ? En quoi un disque du quintette de Schubert serait asservissant alors qu’une vidéo sur internet du même quintette serait libératrice ?
Autre remarque, j’ai déjà écouté des enregistrements avec mes professeurs avec une écoute active, critique, non pour imiter mais pour prendre connaissance des options prises par tel ou tel interprète. C’est le conformisme et l’imitation qui sont désolants, mais ceux-là existaient bien avant l’industrie du disque. Et ils continuent à exister à l’époque d’internet. Ainsi j’ai vu une pianiste chinoise de 10 ans « travailler » une étude de Chopin avec sa mère. Il y avait un portable sur le piano avec une vidéo de Chsaiplusqui qui avais gagné le concours BiduleChouette à Berlin ou Shangaï l’année d’avant. La leçon consistait écouter 10 secondes de vidéo puis imiter scrupuleusement, et recommencer plusieurs fois avant de passer à la section suivante. Avec ce type de méthode, ce n’est pas la musique qu’on reproduit en masse, ce sont les musiciens. On prépare de véritable robots pour les salles de concerts (voir mon post « Terminator » dans le Journal de Papageno)
Une chose est sûre en tout cas : ça n’est pas comme ça que Chopin travaillait !! Il commençait souvent par jouer une pièce de Bach, et puis il improvisait...
Dernier point pour en revenir à la pédagogie : utiliser un enregistreur numérique ou un caméscope pour s’enregistrer soi-même est très utile et très formateur. C’est assez désagréable au début car les défauts sont tellement apparents sur l’enregistrement, mais cela permet de prendre du recul. La vidéo peut apporter un plus car elle montre la connexion entre les mouvements du corps et le son : un violoniste de 7 ans qui voit partir son archet partir de travers en même temps que le son grince fait tout de suite le lien entre les deux. Du reste ça n’est qu’une variante un peu élaborée du miroir que beaucoup de professeurs conseillent à leurs élèves pour travailler.
Voir en ligne : Papageno
24 janvier 2012, 01:08, par Valentin Villenave
Bonsoir,
Pour commencer par la fin : le miroir est effectivement un instrument pédagogique précieux — sans doute moins en cours de piano, mais je ne me prive pas d’imiter mes élèves pour leur montrer leurs défauts (souvent avec une certaine mauvaise foi, mais qui fait partie du rituel). Pour autant, je ne recommande pas de s’enregistrer soi-même car l’expérience peut s’avérer dévastatrice. Particulièrement lorsque les élèves sont habitués à l’illusion du « son studio » que je dénonce plus haut : cela revient alors à comparer une photo de soi, prise n’importe comment, à celle d’un modèle archi-retouché dans un magasine sur papier glacé ; ça n’est gratifiant pour nul d’entre nous, mais dans le cas de pré-adolescents en pleine construction c’est particulièrement peu heureux.
Je ne crois pas avoir chanté (ou alors bien involontairement) les « louanges de YouTube ou IMSLP » — juxtaposition qui me semble d’ailleurs pour le moins hasardeuse, le second étant un site Libre de partitions et le premier un service commercial de vidéos, soit bien peu de choses en commun somme toute. Voir en YouTube un outil intéressant et précieux, ne m’empêche pas de porter un regard critique.
Il y a, cependant, un point commun (et c’est sans doute le seul) entre ces deux sites, qui est précisément leur apport libérateur à la vie culturelle du public et des musiciens : plutôt que de devoir se satisfaire d’un répertoire prémâché ou de se conformer aux injonctions culturelles d’une industrie, le citoyen d’aujourd’hui dispose enfin de la possibilité concrète d’aller lui-même au-devant des œuvres et des genres. (Il ne s’agit là que d’un potentiel, j’insiste sur ce point.)
Et à ce titre, la grande différence entre votre quintette sur YouTube et en disque, est que qui va écouter ledit quintette sur YouTube, ne le fait en général pas dans le même état d’esprit que l’amateur (fétichiste, pour reprendre votre qualificatif) de disques : on ne se rend pas sur YouTube pour la qualité du son (ni même, à de rares exceptions près, de l’interprétation) mais avant tout pour découvrir l’oeuvre elle-même, c’est-à-dire les notes et, si besoin, les paroles. (Ainsi, de nombreux sites proposent des paroles séparément sous forme de texte, qu’il s’agisse de variété, de Lied ou d’opéra : plus besoin de s’acharner à discerner les syllabes ou à juger la prononciation d’une chanteuse.) YouTube véhicule ainsi ce que je qualifie de son illégitime — soit parce que diffusé illégalement, soit parce que de très mauvaise qualité technique — et se situe ainsi à l’opposé de la perfection léchée/aseptisée du disque qui se vend comme « référent » sonore.
Peut-il exister, comme vous le dites, une « écoute active et critique », notamment dans le cadre d’une progression pédagogique ? C’est peut-être possible ; j’évoque moi-même en début d’article ce moment récurrent des cours de chant et d’instrument, qui est souvent le théâtre d’une rivalité d’érudition entre élève et professeur, d’une confrontation sociale — c’est à travers la version que vous citerez ou déclarerez préférer, que s’établira votre légitimité ou votre bon goût. (Et ne me lancez même pas sur le sujet des concours, je m’y montrerais nettement plus hargneux que dans l’article ci-dessus.)
Ayant terminé cet article, déjà long, je me rends compte que j’ai moi-même d’excellents souvenirs d’enregistrements : entre 11 et 14 ans, j’étais un fervent inconditionnel de la bibliothèque/médiathèque où j’ai acquis la majeure partie de ma culture musicale : je n’aurais par exemple eu aucune chance de découvrir les langages musicaux du XXe siècle (du sérialisme à l’électro-acoustique). Ou encore, de véritablement comprendre certaines partitions : ainsi je me souviens que c’est en écoutant en boucle la Deuxième Sonate de Prokofiev enregistrée par F. Chiu, que j’ai pris conscience de la puissance comique de la musique.
Seulement voilà, nous étions alors encore au XXe siècle, la préhistoire d’avant YouTube. Et il me semble que si c’était aujourd’hui, ce n’est point sur des disques que je ferais toutes ces découvertes. (Et, _surtout_, les choses seraient extrêmement différentes si je pouvais avoir immédiatement accès aux partitions plutôt que de devoir découvrir tout cela par le biais d’enregistrements.)
En repensant à ces sonates de Prokofiev (que, comme beaucoup des disques de la bibliothèque, j’ai fini par connaître par cœur et n’ai plus jamais ré-écoutées par la suite), je me dis que finalement, j’ai peut-être eu beaucoup de chance d’avoir été saisi, à l’époque, par la richesse de l’œuvre et de son interprétation... malgré les limitations trompeuses du disque.
(Je n’ai, naturellement, aucune réponse certaine à cette question.)
19 juin 2013, 12:26, par Sharra
Personnellement, je trouve que le son en boîte a parfois du bon.
J’aime bien mes CD de musique classique qui me permettent de compléter ma culture musicale avec un budget moins important que des sorties (qui nécessitent aussi d’avoir à proximité une salle de concert avec une programmation intéressante, mais c’est un autre débat…).
J’aime bien youtube qui m’a permis d’écouter une bonne dizaine d’interprétations différentes de la Chaconne en fa mineur de Pachelbel, et de piocher par-ci par-là des idées que je n’aurais pas eues toute seule. Si bien qu’à l’audition demain soir, je vais jouer MA version, et pas celle de mon prof. Bien sûr, sans lui, je n’aurais pas su apprendre le morceau en entier, mais je suis quand même contente d’avoir ajouté ma touche au lieu de simplement suivre les indications
19 juin 2013, 13:18, par Valentin Villenave
Tout ce qui peut contribuer à élargir ses propres horizons artistiques est bon à prendre (j’imagine que par « CD de musique classique » vous entendez « toute la musique savante de 1500 à 1950 », bien au-delà de l’époque classique qui, au sens strict, ne recouvre guère que la deuxième moitié du XVIIIe siècle). Mais je trouve dommage que, comme vous, la plupart des gens ne « complètent leur culture musicale » qu’avec du son en boîte plutôt que de découvrir par eux-même des partitions, par exemple.
Vous avez raison, cependant, de souligner le rôle toujours plus important de YouTube aujourd’hui (et autres plateformes de diffusion). Les idées à « piocher », comme vous dites, ne sont pas réservées au grands interprètes soutenus par des maisons de disques et par le star-system, c’est d’ailleurs un argument que je développe ci-dessus.
En tout cas, bon courage pour votre audition !